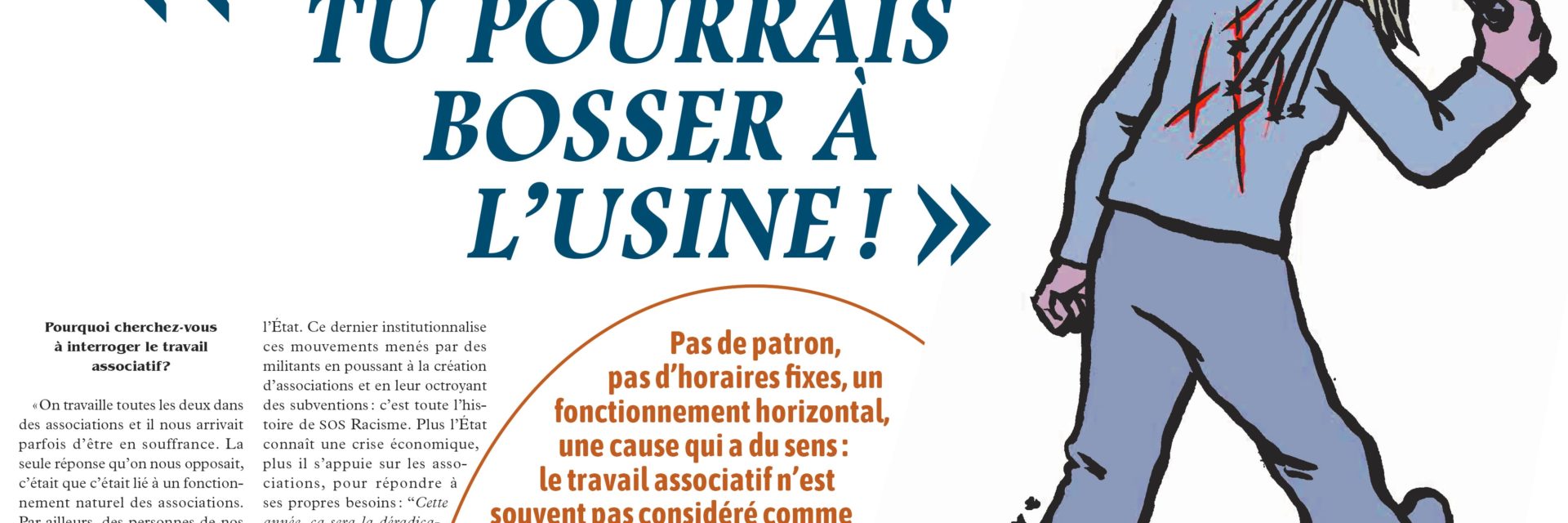Entretien avec l’une des autrices de Te plains pas, c’est pas l’usine. Paru en septembre 2019 dans CQFD n°179.
Pourquoi cherchez-vous à interroger le travail associatif ?
« On travaille toutes les deux dans des associations et il nous arrivait parfois d’être en souffrance. La seule réponse qu’on nous opposait, c’était que c’était lié à un fonctionnement naturel des associations. Par ailleurs, des personnes de nos cercles amicaux, professionnels et militants nous disaient que le problème venait plutôt d’un tournant qu’auraient pris les associations en s’alignant sur une logique de marché. Dernière chose et c’est la plus complexe : dans nos espaces militants, à l’extrême gauche ou dans les milieux anti-autoritaires, beaucoup de personnes, parce que les minimas sociaux ne leur suffisaient plus pour vivre, se sont mises à monter des associations. On ne rejette pas ce modèle en bloc – on conclut d’ailleurs le livre en disant que le travail associatif est évidemment moins pire qu’un boulot à l’usine – mais on a constaté que le fait de monter des associations amoindrit souvent le degré de subversion des pratiques. À partir du moment où l’association touche des subventions publiques, elle est inféodée aux marchés publics. »
S’agit-il alors d’une pente glissante ou est-ce intrinsèque au fonctionnement associatif ?
« Dès la création du statut des associations, en 1901, elles servent à encadrer le mouvement ouvrier qui représente, à l’époque, un pouvoir subversif fort mettant en danger l’État et la production. Proposer aux gens de se monter en association, c’est-à-dire être minimum deux personnes, monter un conseil d’administration, s’enregistrer en préfecture, c’est de base un moyen de contrôle social. L’État donne de plus en plus de missions aux associations dont il ne peut/veut plus se charger lui-même. Dans les années 1970, les luttes – qu’elles soient féministes, antipsychiatriques ou antiracistes – sont progressivement et en partie intégrées par le corps associatif. Et cela arrange bien l’État. Ce dernier institutionnalise ces mouvements menés par des militants en poussant à la création d’associations et en leur octroyant des subventions : c’est toute l’histoire de SOS Racisme. Plus l’État connaît une crise économique, plus il s’appuie sur les associations, pour répondre à ses propres besoins : “Cette année, ça sera la déradicalisation, l’année prochaine, l’écologie.” La pente glissante se situe sans doute à cet endroit-là : les associations ne vivent plus qu’en répondant à des “modes”. Dans les entretiens que nous avons réalisés pour le livre, un salarié nous raconte comment l’association de réduction des risques liés à l’usage de stupéfiants dans laquelle il travaille s’est mise à répondre à des appels d’offres sur de l’hébergement de migrants… alors que ce n’est pas sa mission initiale.Avec la dématérialisation de la Caisse des allocations familiales (CAF) ou du Pôle emploi et la fermeture des accueils, on voit des appels d’offres pour expliquer aux gens comment s’en sortir sur les plateformes numériques. Ils se séparent d’un personnel fonctionnarisé pour se tourner vers des travailleurs associatifs. Cette main-d’œuvre est moins chère et sa mission se termine en même temps que son contrat. Elle est aussi beaucoup moins protégée : il n’y a pas de convention collective des associations ni de réel corps associatif. Du moins pas en tant que corps de métier. »
Peut-on à proprement parler d’exploitation dans le secteur associatif comme le souligne le sous-titre du livre ?
« On ne peut pas parler “d’exploitation” au sens propre du terme : il n’y a pas d’extorsion de la plus-value au détriment du travailleur. Dans le cadre des associations, on ne produit rien. Et c’est aussi pour ça qu’on a du mal à parler de travail lorsqu’on parle du monde associatif. Ce que produit la plus grande partie du secteur associatif, c’est de la paix sociale, de la culture, un monde plus tranquille pour permettre la production. Aussi, il n’y a pas de patron. Il y a un directeur ou une directrice qui, dans les petites et moyennes associations, n’a souvent pas un salaire vraiment plus élevé que les autres salariés, mais qui organise le travail et prend des décisions. C’est aussi pour cela que le cadre est flou. Par ailleurs, il existe une ambiguïté entre le patron et le conseil d’administration – constitué uniquement de bénévoles censés prendre les décisions techniques et politiques, alors qu’ils sont souvent très éloignés de la réalité du terrain. Bref, tu touches un salaire, tu es en partie dirigé par des gens qui n’en ont pas, ton patron te dit qu’il n’est pas vraiment patron… Au final, qui est vraiment ton interlocuteur ? Le vrai donneur d’ordre, c’est finalement l’État. Si tu bosses beaucoup, c’est aussi parce que tu dois boucler un appel à projet proposé par la Ville. Si tu n’y réponds pas à temps, la Ville te coupe les subventions, tu perds ton poste. Le patron associatif est triple : le directeur, le conseil d’administration et les pouvoirs publics. Et aucun ne s’identifie comme ton donneur d’ordre réel. Les rapports de pouvoir sont alors très diffus. »
Ce flou rend donc la lutte des salariés associatifs pour améliorer leurs conditions de travail plus compliquée ?
« En fait, tu ne sais pas vraiment contre qui tu luttes. Récemment, une quinzaine d’associations d’aide et d’accueil aux réfugiés dans le Nord-Est parisien se sont mises en grève du fait des conditions d’exercice de leur travail. On leur coupe leurs subventions tout en leur demandant de pallier les manquements de l’État et en leur envoyant régulièrement les flics. C’est complexe de refuser de servir à bouffer parce que tu es en grève pour dénoncer tes conditions de travail, mais celles-ci seront toujours moins merdiques que les conditions de vie des gens qui vivent là. Cela crée un sentiment de culpabilité énorme. Par ailleurs, il y a là quelque chose de difficilement avouable dans le secteur associatif : tu dois lutter pour la cause, pas pour améliorer tes conditions de travail ni sauvegarder ton emploi. »
Quel lien entretient le monde associatif avec l’économie et le marché du travail ?
« L’associatif, c’est le secteur privé non marchand. Par exemple, notre éditeur est dans le privé non marchand. Pourtant, il vend ce bouquin. Le discours dominant qui place les associations en dehors de l’économie est faux. Par ailleurs, tu retrouves les mêmes contrats que dans le privé : les CDI, les CDD utilisés massivement pour “accroissement temporaire de l’activité”. Et puis il y a tous les contrats de merde : les CDII (contrat à durée indéterminée intermittent) sur le modèle des CDI de chantier : tu es censé être tout le temps disponible pour une mission, mais tu n’as jamais de fixe. Et il y a aussi les spécificités de l’associatif : les CUI/CAE, les PEC [Parcours emploi compétences] et les emplois francs… Chaque gouvernement a proposé ses modèles, ses sigles, qui sont en réalité toujours des variables d’ajustement. »
Il y a aussi tous les boulots qui ne sont pas considérés comme de l’emploi, du type service civique et bénévolat…
« Pour les services civiques, il n’y a pas d’encadrement dans le temps. Tu peux travailler 35 comme 40 heures puisque ce n’est pas censé être du travail, mais du volontariat. Le volontariat, c’est une mission que tu fais pour le sens, contre non pas une rémunération, mais une gratification. La grande idée du volontariat, c’est l’engagement. Mais en réalité, c’est ce qui comble la suppression des emplois aidés et le manque de postes de salariés. La ministre Muriel Pénicaud a d’ailleurs conseillé aux associations, au moment de la suppression des emplois aidés, de se tourner vers les services civiques.Les services civiques sont parfois des personnes diplômées, engagées, plutôt blanches issues de la classe moyenne qui espèrent trouver un emploi pérenne à l’issue de leur service. Mais ce dispositif permet aussi à l’État, sous couvert d’engagement, de gérer ce qu’il appelle les “excédentaires” : recaser les pauvres, sans diplômes, issus des quartiers. Un public qui ne fait pas ça par engagement – non pas parce qu’il serait moins engagé que les autres – mais bien parce que c’est le seul boulot auquel il peut prétendre. On a rencontré un habitant d’un quartier populaire qui avait plus de responsabilités que certains salariés et gérait même leur planning alors qu’ils sortaient tous de masters d’économie sociale et solidaire. Lui était en service civique, tout ça pour 530 euros.Et puis il y a la question du bénévolat. Qui est bénévole ? Qui peut se permettre de donner du temps à une association ? Pour comprendre, on s’est appuyées sur les recherches de la sociologue du travail Maud Simonet, qui définit trois catégories de bénévoles. Il y a d’une part les retraités, d’autre part des gens qui donnent du temps en espérant un emploi à la clef, et enfin, les bénévoles contraints. Cette dernière catégorie est composée de gens qui donnent du temps contre des miettes ou qui font ça pour ne plus être harcelés par la CAF ou le Pôle Emploi. D’ailleurs, de nombreuses collectivités locales expérimentent le fait de conditionner les minimas sociaux au temps bénévole consacré à une association. Dans ce type de bénévolat, on retrouve aussi les TIG (travaux d’intérêt général). Ce ne sont évidemment pas les mêmes tâches que dans du volontariat : elles sont bien plus dégradantes et abrutissantes. Les services civiques de ramassage des déchets dans les quartiers en sont une bonne illustration. »
Vous abordez aussi la question du travail pair, par exemple un usager de drogue salarié dans une association de réduction des risques. Ce statut constitue-t-il aussi une variable d’ajustement ?
« On ne dénonce pas le travail pair en soi. Il est évidemment important que les personnes concernées puissent devenir travailleuses sociales. Ce qu’on constate par contre, c’est que les travailleurs pairs n’ont souvent pas le même statut en interne dans les associations. Soit formellement : ils sont moins payés parce que non diplômés. Soit socialement : ils ne sont pas conviés aux réunions d’équipe, ils ne prennent pas part aux décisions importantes. On note dans nos entretiens que certaines personnes sont recrutées pour donner une image un peu “marginale” à l’association, donc vendeuse auprès des pouvoirs publics. Et encore une fois, on constate des situations aberrantes, notamment le cas d’une personne bénévole dans une association depuis des lustres et qui se retrouve à faire une période d’essai pour avoir un emploi aidé.Le travailleur pair est surtout présent dans le travail social, type réduction des risques, travailleuses du sexe. On t’embauche parce que tu vas nous faire accepter dans les squats de toxicos, dans la rue avec les putes, dans la cité. Mais on te fera toujours sentir qu’il ne faut pas trop monter. Une personne en service civique pour une association d’aide aux devoirs dans un quartier nous a confié qu’une fois son service terminé, l’association lui a demandé de continuer sa mission, mais gratuitement, parce qu’il connaissait bien les familles. “À ce moment-là, ça les arrange bien que j’aie un pied dans les deux camps”, nous a-t-il dit. »
Vous proposez le concept d’« idéologie du dévouement ». Peut-on finalement parler, dans le cadre du travail associatif, d’auto-exploitation ?
« Le dévouement, c’est l’huile dans les rouages de la machine associative. Il est d’abord basé sur le rapport aux bénéficiaires. Et il y a aussi celui qui repose sur la peur de mal faire son travail. Comme tu es précaire, que tes collègues et la structure le sont aussi, tu devras bosser davantage pour répondre à des appels à projet dans un domaine auquel tu ne connais peut-être rien.Ensuite, il y a l’aspect relationnel et c’est surtout le cas dans les petites structures. Ton directeur peut être ton ami et tu sais qu’il a sué pour monter sa structure et la faire vivre. Mais cette proximité peut parfois créer une sorte de mythologie de la grande famille et du “On donne des heures pour que le monde aille mieux”. Comme le travail associatif n’est pas considéré comme un vrai travail, tu peux bien faire 40 ou 50 heures par semaine, ne jamais voir tes heures supplémentaires payées puisque c’est avant tout un dévouement. »
Comment alors lutter dans le secteur associatif ?
« Il ne peut pas y avoir de lutte victorieuse dans le secteur associatif sauf à détruire le secteur associatif, ce qui n’est pas notre objectif : on continue à être travailleuses associatives et à bouffer grâce à lui. Et puis ce n’est jamais en prenant une lutte sectorielle qu’on met à mal tout un système. La lutte contre la suppression des CUI/CAE en 2017 était assez bordélique. Des communiqués réunissaient des gens du CNEA (le syndicat des patrons associatifs) qui vantent les bienfaits des contrats aidés dans le cadre de la réinsertion, et des gens opposés à ce type de contrats précaires, mais qui luttaient simplement pour sauvegarder leur poste. C’était la même absurdité lors d’une action de tractage devant un CRIJ (Centre régional information jeunesse) pour une journée de “recrutement de service civique”. Les personnes dans un parcours d’engagement recevaient plutôt bien notre discours, mais on a eu des réactions parfois violentes de la part des autres, des galériens, ceux qui n’étaient pas là par choix. Ça dit bien toute l’ambiguïté des luttes dans ce secteur. »
Vous espérez libérer une parole en sortant ce bouquin ?
« On espère d’abord que les travailleurs associatifs seront soulagés de lire que ce qu’ils vivent est vécu par d’autres gens. Là-dessus, le livre Nous n’irons plus pointer chez Gaïa, jours de travail à Kokopelli nous a beaucoup marquées, car la souffrance dans le travail associatif est souvent inavouable. Plus largement, le secteur associatif est très avant-gardiste et a beaucoup inspiré les techniques de team building et de néo-management aussi via la précarisation des contrats ou le recours au volontariat. Des boîtes privées du secteur marchand proposent dorénavant du volontariat, le SNU (Service national universel) surfe à fond sur l’idéologie de l’engagement et la défense des valeurs, comme pour le service civique. Il nous faut plus que jamais penser ces nouvelles formes de travail. »